| Numéro |
Cah. Agric.
Volume 34, 2025
Family Farming in the Transition towards Sustainable Society / L’agriculture familiale dans la transition vers une société durable. Coordonnateurs : Pierre-Marie Bosc, Kae Sekine, Nora McKeon, Jean-Michel Sourisseau
|
|
|---|---|---|
| Numéro d'article | 23 | |
| Nombre de pages | 13 | |
| DOI | https://doi.org/10.1051/cagri/2025024 | |
| Publié en ligne | 9 juillet 2025 | |
Article de recherche / Research Article
Rareté foncière, inégalités et intensification à Madagascar : une analyse comparée à l’échelle des ménages dans cinq zones contrastées
Land scarcity, inequalities and land intensification in Madagascar: a comparative analysis at household level in five agroecological areas
1
CIRAD, UMR ART-DEV, F-34398 Montpellier, France
2
ART-DEV, Univ. Montpellier, CIRAD, F-34000 Montpellier, France
3
Centre Ivoirien de Recherches Économiques et Sociales, Univ. F. Houphouët Boigny, Abidjan, Côte d’Ivoire
4
CIRAD, UMR TETIS, F-34398 Montpellier, France
5
TETIS, Univ. Montpellier, AgroParisTech, CIRAD, CNRS, IRSTEA, F-34000 Montpellier, France
6
Think Tany, Antananarivo, Madagascar
7
École Supérieure d’Agronomie, Université d’Antananarivo, Antananarivo, Madagascar
8
CIRAD, UMR MoISA, F-34398 Montpellier, France
9
MoISA, Univ. Montpellier, CIHEAM-IAMM, CIRAD, INRAE, Institut Agro, Montpellier, France
10
Université de Montpellier, Montpellier, France
11
GSDM Professionnels de l’Agroécologie, Antananarivo, Madagascar
12
L’institut Agro de Montpellier, Montpellier, France
13
Centre national de la recherche appliquée au développement rural (FOFIFA), Département de Recherche-Développement, Antananarivo, Madagascar
* Auteur correspondant : hadrien.di_roberto@cirad.fr
L’agriculture familiale fait face à des défis importants, parmi lesquels la raréfaction des terres arables dans des contextes de forte croissance démographique. À Madagascar, l’agriculture est essentiellement familiale et concerne plus de 80 % des ménages du pays. L’accès aux terres agricoles est un enjeu central pour ces familles et la rareté des terres arables est un facteur majeur de transformation des systèmes agraires. Pourtant, peu de données et d’analyses récentes existent sur les caractéristiques et les inégalités foncières à l’échelle des exploitations et des régions. Dans ce contexte, l’article analyse les disponibilités foncières des ménages et leurs perspectives d’intensification. Il valorise 10 bases de données produites par différentes équipes de recherche, ces 10 dernières années. Sur la base de données agrégées de 6000 ménages dans 5 zones agroécologiques du pays, l’article apporte trois contributions principales à la compréhension des agricultures familiales : la caractérisation de la rareté foncière à l’échelle des ménages en termes de quantité et de qualité, la mise en évidence d’inégalités foncières inter et intra zones agroécologiques, et l’identification de pratiques d’intensification foncière.
Abstract
In Madagascar, farming is essentially family-based and concerns 80% of the country’s households. Access to farmland is a central issue for these families, and the scarcity of arable land is a major factor in the transformation of agrarian systems. Yet few recent data and analyses exist on the characteristics and inequalities of land tenure at farm and regional levels. Against this backdrop, this article analyzes household land availability and intensification prospects in several regions of Madagascar. It draws on 10 databases produced by various research teams over the last 10 years. Based on this aggregate database of 6,000 households in 5 agro-ecological zones of the country, the article makes three main contributions to the understanding of family farming: characterizing land scarcity at household level in terms of quantity and quality, highlighting land inequalities between and within agro-ecological zones, and identifying land intensification practices.
Mots clés : accès aux terres / rareté foncière / intensification / agriculture familiale / Madagascar
Key words: land access / land scarcity / intensification / family farming / Madagascar
© H. Di Roberto et al., Hosted by EDP Sciences 2025
 This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License CC-BY-NC (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, except for commercial purposes, provided the original work is properly cited.
This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License CC-BY-NC (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, except for commercial purposes, provided the original work is properly cited.
1 Introduction
L’agriculture familiale est un pilier des systèmes agricoles dans le monde. La communauté internationale et la littérature scientifique ont reconnu son rôle central pour répondre aux défis mondiaux, alimentaires, économiques et environnementaux (Gaitán-Cremaschi et al., 2022 : HLPE, 2013 ; Sourisseau, 2015). Bien que diverse et résiliente (Id.), l’agriculture familiale fait face à des défis importants, parmi lesquels la raréfaction des terres arables dans des contextes de forte croissance démographique. Cette contribution propose une analyse des dynamiques des agricultures familiales à Madagascar avec une focale sur les enjeux d’accès au foncier.
À Madagascar, l’agriculture est essentiellement familiale et implique plus de 80 % des ménages du pays (INSTAT, 2020). Elle est le premier secteur d’emploi et devrait le rester, car la croissance démographique demeure forte, tandis que les créations d’emplois dans les secteurs secondaires et tertiaires stagnent (Dabat et al., 2008 ; Sourisseau et al., 2016 ; Razafindrakoto et al., 2018). Avec deux à trois millions d’hectares cultivés, le pays pourrait disposer de vastes réserves foncières (hors forêts) pour l’agriculture, allant de 8 à 20 millions d’hectares selon les études et les cultures considérées (MAEP, 2009 ; World Bank, 2017). Paradoxalement, la rareté foncière dans les zones agricoles est une préoccupation centrale des agriculteurs et représente un défi majeur dans les zones de peuplement ancien. Au-delà des vastes plaines dédiées à l’élevage, les zones agricoles sont sous contrainte avec des superficies agricoles cultivables faibles et qui diminuent au fil des générations (Bélières et al., 2016, 2017 ; Boué, 2013 ; Burnod et al., 2014, 2017 ; Di Roberto, 2020). Ces tendances sont d’autant plus préoccupantes que les liens entre superficie cultivable et pauvreté sont forts (Andrianantoandro et Bélières, 2015 ; Banque mondiale, 2014 ; Gondard-Delcroix, 2009 ; INSTAT, 2022). Ainsi, parce que le nombre d’exploitations agricoles est encore appelé à augmenter, l’accès au foncier et le niveau d’intensification sont des éléments clés de la durabilité de l’agriculture familiale dans ce pays.
Dans les sphères académiques, comme dans celles du développement, la rareté des terres est depuis longtemps reconnue comme un facteur majeur de transformation des systèmes agraires, et notamment d’intensification agricole (Malthus, 1798 ; Boserup, 1965). À Madagascar, peu de données nationales et récentes sont disponibles sur les contraintes foncières des exploitations agricoles familiales. Le dernier recensement agricole date de 2004 et peu de travaux traitent des inégalités foncières entre régions et entre ménages. Dans ce contexte, l’article analyse, dans plusieurs zones de Madagascar, les disponibilités foncières des ménages et leurs perspectives d’intensification. Ancré dans le champ de l’économie des ménages, cet article se présente comme une première étape de capitalisation de données existantes, qui, regroupées, offrent de nouvelles perspectives de valorisation. Il mobilise des données quantitatives produites par différentes équipes de recherche au cours des 10 dernières années, concernant au total plus de 6000 ménages dans 5 zones agroécologiques du pays. Avec cette focale sur le foncier, l’article documente un domaine sensible à Madagascar, véritable enjeu pour le devenir de l’agriculture familiale, et en particulier pour les jeunes générations.
2 Cadrage
2.1 Problématique et justification : raréfaction des terres arables et croissance démographique
Depuis les travaux de Malthus (1798) et Boserup (1965), la rareté foncière est reconnue comme un facteur central des transformations des systèmes économiques ruraux. Une abondante littérature concerne les transformations induites par la rareté des terres, les quatre principales étant :
l’intensification et la diversification des systèmes de production agricole et d’élevage (fréquence des cultures, irrigation, recours aux intrants – engrais, produits phytosanitaires, alimentation animale, etc.) (Headey et al., 2014 ; Jayne et al., 2014) ;
la diversification des systèmes d’activités menant à une augmentation des activités extra-agricoles (Bosc et al., 2015 ; Haggblade et al., 2010) ;
la migration à destination de territoires urbains ou ruraux, aux échelles nationales et sous-régionales (Losch, 2016 ; Mercandalli et al., 2019) ;
le changement des structures familiales et de la natalité (Guirkinger et Platteau, 2015, 2019 ; Headey et al., 2014 ; Jayne et al., 2014).
Jayne et al. (2014) proposent un cadre analytique synthétique pour aborder le rôle des contraintes foncières dans la transformation des systèmes agraires. Ils distinguent les déterminants de la rareté (à l’échelle des territoires), et les réponses mises en œuvre pour surmonter cette contrainte (à l’échelle des ménages agricoles) (Fig. 1).
À Madagascar, l’accès aux terres agricoles représente une contrainte majeure pour les jeunes qui démarrent leur activité agricole (Burnod et al., 2016 ; Di Roberto, 2019). La pression foncière est régulièrement citée comme cause de la pauvreté rurale (Droy et al., 2010, 2013 ; Gondard-Delcroix, 2009 ; Minten et al., 2003). Cependant, la rareté foncière reste difficile à mesurer du fait du manque de données, aussi bien à l’échelle régionale que nationale. La tendance observée entre les deux derniers recensements agricoles (1984 et 2004) était celle d’une baisse des superficies moyennes des exploitations agricoles de 1,2 hectare à 0,87 hectare (Sourisseau et al., 2016). À l’heure actuelle, la superficie moyenne des exploitations agricoles à l’échelle nationale n’est pas connue, mais le prolongement tendanciel des deux derniers recensements permet de faire l’hypothèse qu’elle serait réduite à 0,67 hectare en 2024 (op. cit). Le dernier recensement général de la population de 2018 a inventorié plus de 5 millions de ménages – dont 83 % agricoles – mais n’informe pas de la superficie dont les ménages disposent (INSTAT, 2020). Ces superficies peuvent être estimées sur la base d’études ponctuelles et par la valorisation des données du Réseau des observatoires ruraux (ROR), qui a fourni des données de ce type pendant près de deux décennies (Droy et al., 2000). Cependant, ces données concernent principalement les superficies des rizières. De plus, elles ont été peu utilisées pour des analyses comparées entre zones, avec quelques exceptions (Andrianirina, 2013 ; Andrianirina et al., 2011 ; Losch et al., 2010 ; Randrianarison et al., 2009). Par ailleurs, les analyses existantes se limitent souvent aux superficies moyennes des exploitations agricoles, sans traiter de la variabilité. Les différences entre superficie moyenne des exploitations, superficie utilisée par actif et superficie cultivée sur l’ensemble de l’année sont rarement mobilisées malgré leur pouvoir explicatif pour mieux cerner le caractère limitant et le degré de valorisation des ressources foncières.
Afin de mieux caractériser la rareté foncière à Madagascar, cet article analyse les disponibilités foncières effectives des ménages en termes de quantité et qualité, leurs déterminants et leurs liens avec les pratiques d’intensification foncière (Fig. 1, parties grisées). D’autres réponses potentielles des ménages au manque de terres agricoles existent et ont été identifiées (Fig. 1), telles que la migration, des changements d’activité ou d’organisation familiale, mais elles ne sont pas traitées dans cet article.
 |
Fig. 1 Cadre d’analyse : déterminants et effets de la rareté foncière ; en grisé, les aspects traités dans cet article. Analysis framework: determinants and effects of land scarcity; in grey, the aspects dealt with in this article. |
2.2 Méthodologie
À défaut de statistiques récentes au niveau national sur les exploitations agricoles, cet article valorise des données primaires, collectées lors de 10 enquêtes réalisées par les auteurs et leurs partenaires (Tab. 1) entre 2015 et 2022. La consolidation des bases de données a permis de construire un échantillon de 6041 exploitations agricoles (EA) qui offre un panorama des agricultures familiales dans 47 communes situées dans 5 zones agroécologiques différentes (Fig. 2). Cela représente à notre connaissance la plus grande base disponible de données récentes sur les patrimoines fonciers. Dans le cadre de ces enquêtes, le choix des communes a été raisonné et au sein de chaque commune, les villages et les exploitations agricoles ont été sélectionnés par tirage aléatoire. Un coefficient permet de représenter statistiquement les 110 469 ménages vivant dans les communes étudiées. Il assure la bonne représentativité des ménages, car dans certaines enquêtes le tirage au sort a été fait dans deux listes (population appuyée par le projet et population hors projet) et il permet de prendre en compte le poids démographique des communes de chacune des 5 zones d’analyse. Pour la présentation des résultats, les communes ont été regroupées en cinq zones géographiques (Hautes Terres, Moyen-Ouest, Est, Nord, Ouest), selon un découpage en zones agroécologiques, basé sur la combinaison de facteurs pédologiques, climatiques et culturels, utilisée dans des travaux de référence (Minten et al., 2003). Ces regroupements facilitent la présentation des résultats et permettent d’illustrer les situations contrastées d’au moins une partie des zones agroécologiques concernées. Il faut souligner que nos résultats sont représentatifs à l’échelle des groupes de communes ainsi constitués (en couleur sur la carte de droite de la Figure 2) et non à l’échelle des zones agroécologiques dans leur ensemble (hachurées sur la carte de gauche de la Figure 2). Le regroupement des données des enquêtes s’est limité aux variables identiques, définies de la même façon et basées sur les mêmes modalités de réponse. Ce regroupement a porté sur l’ensemble des enquêtes pour la majeure partie des variables (par exemple le nombre d’actifs, la superficie totale possédée, les modes de faire-valoir, la superficie totale cultivable, etc.) et il s’est parfois limité à un sous-ensemble d’enquêtes (par exemple pour la superficie cultivée par année). Les outils utilisés dans cet article sont essentiellement des statistiques descriptives et des analyses bivariées. L’interprétation des résultats repose sur des observations, des entretiens qualitatifs et la présence longue des chercheurs dans les zones rurales étudiées.
Pour étudier la rareté foncière, l’article analyse la disponibilité foncière des exploitations agricoles en s’appuyant sur trois variables. La première est la superficie possédée (SP). Elle nous informe sur le patrimoine foncier que détient le ménage. La deuxième variable est la superficie agricole utilisée (SAU). Elle capte la superficie cultivable disponible pour l’exploitation l’année étudiée. Elle comprend les terres possédées (SP) et les terres prises en faire-valoir indirect (FVI), desquelles on retranche les terres cédées en FVI et les terres non cultivables (plantations forestières, terres de parcours, étangs et superficies bâties, mais pas les jachères qui restent dans la SAU). La SAU ramenée par actif offre un bon indicateur de comparaison entre zones, et entre ménages, sur la disponibilité ou la rareté des terres. Bien entendu, cela se fait en prenant en compte les systèmes de production existants. La troisième variable est la superficie cultivée (SC). Elle correspond à la superficie totale mise en valeur pour l’agriculture pendant l’année, en incluant le nombre de cycles réalisés sur une même parcelle. Ainsi, une parcelle de 1 hectare cultivée en saison principale, puis en contre-saison, sera comptabilisée deux fois : la SC sera égale à 2 hectares.
Localisation, année et nombre d’exploitations agricoles (EA) de l’échantillon.
Location, year and number of farms in the sample.
 |
Fig. 2 Carte des zones agroécologiques (à gauche) et des communes étudiées (à droite). Map of agro-ecological zones (left) and surveyed municipalities (right). |
3 Disponibilités foncières des ménages en termes de quantité et qualité
De manière générale, les disponibilités foncières sont faibles, quelles que soient les zones. Le Tableau 1 montre que les superficies agricoles utilisées (SAU) moyennes par actif restent inférieures à 1 hectare.
La variabilité interzone de la SAU est nette et montre que les exploitations de l’Ouest, du Moyen-Ouest et du Nord sont dans une situation moins contrainte (de 0,6 à 0,8 ha/actif) que les zones des Hautes Terres et le Sud-Est (0,3 ha/actif). Ces chiffres traduisent une capacité productive contrainte par le foncier avec un très faible niveau de mécanisation (par exemple, beaucoup d’exploitations n’ont ni charrette ni bœuf de trait). Ils restent bien en deçà de la superficie cultivable du fait des limites techniques du travail manuel, souvent estimées autour de 1 ha par actif en Afrique (Benoit-Cattin et Dorin, 2012 ; Havard et al., 2004) et révèlent que l’accès aux terres est une contrainte majeure. Ces différences de disponibilité foncière sont cohérentes avec l’histoire et les dynamiques de peuplement de chacune de ces zones. Le Moyen-Ouest, l’Ouest et le Nord sont des territoires d’immigration (47 % à 51 % des chefs d’exploitation agricole sont migrants), attractifs par leur moindre pression foncière. Le Sud-Est et les Hautes Terres accueillent peu de migrants (4 % à 10 % des chefs d’EA) et sont au contraire des zones de départ lié à la recherche d’emplois ou de terres agricoles (Burnod et al., 2017).
La disponibilité foncière des terres en termes de qualité peut être appréhendée par différents critères. Nous distinguons trois types de parcelles qui traduisent, de façon grossière mais synthétique, la qualité du sol, l’accès à l’eau et la pente (cf. Fig. 3). En général, les bas-fonds sont des sols fertiles, irrigués et cultivés en riz et en légumes (en contre-saison). Les terres de qualité intermédiaire sont les « baiboho », situés en bas des pentes, moins bien irrigués et cultivés pour le riz et le maraîchage. Les collines ou plateaux (appelés « tanety ») sont généralement des sols pauvres en matière organique, souvent en pente. Ils accueillent des cultures pluviales (maïs, manioc, légumineuses, riz pluvial, etc.). Les paysages des Hautes Terres sont caractérisés par une succession de collines et de rizières irriguées en terrasse ou dans des bas-fonds assez étroits. Dans le Moyen-Ouest se succèdent aussi des petits bassins versants avec des bas-fonds, mais de larges plateaux surélevés (de tanety) les séparent. Dans l’Ouest et le Nord, de grandes plaines sont traversées par des rivières entourées d’espaces inondables (les baiboho), qui sont séparés par des espaces savanicoles légèrement surélevés. Les disponibilités foncières sont plus importantes et les bas-fonds et baiboho sont privilégiés.
Les données collectées permettent d’apprécier l’importance des différents types de terres appropriées dans les terroirs (cf. Fig. 4). Sur les Hautes Terres, alors que les terres de colline (tanety) sont moins importantes dans les paysages (par rapport aux communes étudiées du Moyen-Ouest notamment), elles représentent plus de 60 % des espaces appropriés. L’importance de ces tanety dans les exploitations agricoles est un marqueur de la pression foncière et témoigne d’une stratégie de diversification vers des terres de moindre qualité. Nous pouvons aussi calculer que, dans les communes étudiées des Hautes Terres, du Sud-Est, du Moyen-Ouest et du Nord, la grande majorité des exploitations agricoles (78 % à 92 %) disposent de deux grands types de terres : bas-fonds/baiboho et tanety. Celles qui n’ont qu’un seul type de terre sont aussi en moyenne plus petites, et cela de manière plus nette encore dans les zones à forte pression foncière comme les Hautes Terres et le Sud-Est.
 |
Fig. 3 Types de parcelles : illustration avec un paysage des Hautes Terres. Plot types: illustration with a Hautes Terres landscape. |
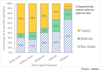 |
Fig. 4 Composition des terroirs appropriés dans les zones agroécologiques. Composition of land used in agro-ecological zones. |
4 Modes d’accès aux terres et inégalités intra-zone
4.1 Des modes d’accès différenciés aux terres agricoles
La rareté foncière rencontrée par les ménages dépend des opportunités d’accès aux terres. Les opportunités d’accès à la possession se font via la défriche (mise en valeur agricole d’une parcelle non encore cultivée caractérisée par un couvert de savane ou forestier), l’héritage ou le marché foncier de l’achat-vente. L’accès à l’usage passe par des prêts (à titre gratuit) ou la prise en faire-valoir indirect (location et métayage).
La défriche est un mode d’accès limité, mais significatif de la pression foncière. Dans le Moyen-Ouest et le Sud-Est, la défriche ne concerne qu’une très faible part du foncier possédé (1 % et 2 %), ce qui indique une appropriation ancienne des terroirs (Tab. 2). Dans les Hautes Terres, malgré le peuplement ancien et la forte pression foncière, elle représente 8 % des superficies possédées. Cela s’explique par une forte demande qui pousse les ménages à mettre en valeur des tanety de très faible qualité agronomique. La défriche est plus importante dans l’Ouest et le Nord, où l’expansion agricole se poursuit.
L’héritage est le principal mode d’accès à la terre (de 48 % à 72 % des superficies possédées). Il est plus important dans les zones des Hautes Terres et du Sud-Est. Le recours aux marchés pour l’achat de foncier est notable dans l’ensemble des zones et représente in fine 18 % à 44 % du foncier possédé, et concerne entre 24 % et 54 % des exploitations agricoles. L’achat de terre est plus faible dans le Nord (24 % des exploitations) et s’explique par le fort taux de défriche (31 % des exploitations). Dans l’Ouest et le Moyen-Ouest, le marché de l’achat-vente est très actif et dynamisé par la présence des migrants (cf. Tab. 2).
La prise en faire-valoir indirect (FVI), notamment à travers la location et le métayage, est une pratique commune qui concerne entre 23 % et 50 % des ménages selon les zones étudiées. Le plus faible taux (23 % des exploitations) est dans la zone Nord où la défriche est importante. Les taux des Hautes Terres et du Sud-Est sont proches (25 %), car comme pour les achats, le marché est réduit par manque d’offre. Les taux sont les plus élevés dans le Moyen-Ouest et l’Ouest, où la pression foncière est moindre et le marché plus dynamique. Pour l’essentiel des ménages (98 % à 82 % selon les zones), le faire-valoir indirect reste un mode d’accès à la terre complémentaire à la possession foncière.
Caractéristiques des exploitations selon les communes, regroupées par zone agroécologique.
Farm characteristics by commune, grouped by agro-ecological zone.
4.2 Des inégalités foncières intra-zones
La distribution des exploitations agricoles par classe de superficie permet d’appréhender les inégalités foncières au sein de chaque zone. La Figure 5 présente, par classe de superficie, la répartition des exploitations et la superficie possédée. Elle met en évidence deux points remarquables de la structuration agraire. De manière générale, les exploitations de grande taille (> 3 ha) sont peu nombreuses (entre 6 % et 19 % des exploitations), mais concentrent une part importante de la superficie agricole des territoires (entre 34 % et 64 %). Les très petites exploitations (inférieures ou égales à 0,5 ha) sont nombreuses (de 25 % dans le Moyen-Ouest à 53 % dans les Hautes Terres), mais elles ne possèdent que 2 % à 14 % de la superficie agricole.
De manière spécifique, le profil des communes étudiées dans les Hautes Terres se caractérise par de très nombreuses exploitations avec de petites superficies (74 % des exploitations ont moins de 1 ha et représentent ensemble 30 % du territoire étudié) et quelques rares exploitations de grande taille. Le profil de la zone étudiée au Sud-Est est similaire. Dans le Moyen-Ouest, les très petites exploitations sont moins nombreuses (seulement 46 % ont moins de 1 ha) et les grandes exploitations y sont plus représentées (12 % ont plus de 3 ha) avec une part conséquente du terroir (40 % des superficies). Les inégalités sont particulièrement prononcées dans les communes du Nord et de l’Ouest. La part des très petites exploitations (< 0,25 ha) reste importante, représentant respectivement 27 % et 32 % des exploitations, tout comme les grandes exploitations (> 3 ha) qui représentent respectivement 17 % et 19 % des exploitations. Les petites exploitations ne détiennent que 2 % à 3 % de la superficie agricole du territoire, tandis que les grandes cumulent respectivement 55 % et 63 % de cette superficie.
Le faire valoir indirect (FVI – location, métayage et prêts) permet de réduire les inégalités entre exploitations (Tab. 3). Malgré l’apport conséquent du faire valoir indirect qui représente 20 à 51 % de la superficie, les exploitations avec FVI ont en moyenne une superficie disponible toujours inférieure aux exploitations sans FVI, sauf pour la zone Nord qui apparaît encore une fois différente, peut-être en lien avec la taille des parcelles.
 |
Fig. 5 Répartition des exploitations agricoles et des superficies possédées selon les classes de superficie par exploitation et par zone. Distribution of farms and acreage owned according to acreage classes per farm and zone. |
Contributions relatives des différents modes d’accès à la terre.
Relative contribution of different modes of access to land.
5 L’intensification foncière pour compenser les faibles surfaces cultivables
L’une des options possibles pour compenser une superficie agricole insuffisante est d’augmenter le taux de mise en valeur des terres. Cela passe généralement par l’abandon des jachères et la pratique de plusieurs cycles de culture par an sur une même parcelle. Cela est rendu possible par l’éventail des systèmes de culture praticables (riz suivi de maraîchage, cultures de cycle court, etc.) et la réalisation d’aménagements fonciers (irrigation, terrasses, buttes ou planches, etc.). Cette augmentation du taux de mise en valeur constitue une dimension de l’intensification agricole. Ce taux est déterminé en divisant la superficie cultivée en une année par la SAU. Si une parcelle est cultivée entièrement deux fois dans l’année (par exemple riz irrigué en grande saison puis maraîchage en contre-saison), le taux de mise en valeur est égal à 2. Pour les cultures pérennes, le taux reste de 1. Les résultats sont présentés dans le Tableau 2.
Les comparaisons inter-zones montrent des taux moyens d’intensification autour de 1,0 dans les communes étudiées du Moyen-Ouest, 1,2 au Sud-Est, 1,3 à l’Ouest et 1,4 dans les Hautes Terres. Pour la zone Nord, cette information n’est pas disponible (cf. Tab. 1). Plusieurs facteurs pourraient expliquer ces différences. Le premier tient aux conditions climatiques (température et pluviométrie) favorables à la pratique de deux cycles de culture, comme nous l’avons observé dans les communes du Sud-Est et l’Ouest. D’autres facteurs d’intensification sont liés à la qualité des terres (sols, aménagements pour l’irrigation), aux débouchés (proximité des marchés) et à la pression foncière qui expliqueraient notamment l’intensification foncière dans les Hautes Terres, malgré un climat moins propice aux cultures de contre-saison. Les meilleures disponibilités foncières, l’accès à l’eau limité dans les rizières, la pratique de la jachère qui n’a pas disparu et l’éloignement des marchés urbains nous semblent en partie expliquer le taux de mise en valeur limité à 1 dans les communes étudiées du Moyen-Ouest.
Par ailleurs, au sein d’une même zone avec des systèmes de production manuels, on peut émettre l’hypothèse que les exploitations ayant de petites superficies cultivables ont tendance à intensifier l’utilisation du foncier, puisqu’elles disposent par ailleurs de la main-d’œuvre familiale pour le faire. À l’inverse les grandes exploitations avec une superficie importante seraient plus contraintes par la main-d’œuvre familiale, et auraient tendance à moins intensifier l’utilisation du foncier et à utiliser des pratiques comme la jachère. La Figure 6 permet de comparer les taux de mise en valeur par classe de superficie et par zone agroécologique. Les données observées sur les Hautes Terres et le Moyen-Ouest confirment cette hypothèse. Pour les Hautes Terres, le taux de mise en valeur diminue de 1,4 pour les petites exploitations à 1,1 pour les plus grandes. Pour le Moyen-Ouest, la tendance est la même avec un taux allant de 1,1 à 0,9 pour les grandes exploitations. Pour le Sud-Est, la tendance baisse également, mais n’est pas significative avec une courbe chaotique. Dans cette zone, les systèmes de production ont une forte composante en cultures pérennes qui peut influer sur le taux de mise en valeur. Enfin pour les communes étudiées de l’Ouest, on observe un taux de mise en valeur élevé qui, contrairement aux autres zones, augmente avec la superficie de l’exploitation. Ici, en l’absence de pression foncière, l’intensification est à mettre en lien avec la présence de systèmes irrigués ou inondés qui permettent la double culture, notamment riz-légumineuses ou riz-maraîchage. De plus, l’agriculture commerciale y est plus développée. Même si la motorisation est un peu plus développée que dans les autres zones, nos observations suggèrent que ces systèmes de l’Ouest restent très largement manuels ou en traction animale, et les taux élevés d’intensité foncière dans les grandes exploitations sont à mettre en lien avec la disponibilité en main-d’œuvre extérieure.
Ainsi, dans les zones avec des systèmes de production manuels et avec une forte composante de cultures annuelles, l’intensification foncière est une adaptation à la raréfaction de la terre, comme l’indiquent les résultats sur les Hautes Terres et le Moyen-Ouest. Pour les communes étudiées de l’Ouest, l’intensification foncière semble davantage liée aux conditions pédoclimatiques favorables, à l’importance des cultures commerciales, à la disponibilité en main-d’œuvre extérieure et à une motorisation naissante pour les grandes exploitations.
 |
Fig. 6 Évolution du taux de mise en valeur selon la superficie agricole utile de l’exploitation. Evolution of the development rate according to the usable farm area. |
6 Conclusion
Parmi les défis de l’agriculture familiale à Madagascar, la diminution de la superficie des exploitations et la pression foncière apparaissent comme des problématiques centrales. Pourtant, nombre de discours et de mesures politiques suggèrent l’existence de grandes disponibilités de terres arables pour installer des firmes et de grandes exploitations agricoles commerciales (Bélières et al., 2016). Pour éclairer ces débats, l’article a tenté de caractériser la rareté foncière observée à l’échelle des ménages ruraux et interroge la capacité du modèle d’agriculture familiale malgache à absorber la croissance démographique sans accentuer la pauvreté rurale. À partir d’enquêtes quantitatives hétérogènes produites par différentes équipes de recherches ces 10 dernières années, nous avons analysé la disponibilité foncière et les conditions d’accès aux terres des ménages ruraux dans 47 communes dans 5 zones, proposant ainsi des comparaisons rares à cette échelle à Madagascar.
L’article confirme que les superficies agricoles utilisées sont particulièrement faibles dans les communes étudiées des Hautes Terres et de l’Est. Les ménages considérés de l’Ouest, du Moyen-Ouest et du Nord sont en moyenne mieux dotés. Toutefois, et de manière moins attendue, le nombre de très petites exploitations y reste important (entre un quart et la moitié des exploitations) constituant ainsi une réserve de main-d’œuvre pour les exploitations mieux dotées. Concernant l’accès aux terres, les marchés fonciers d’achat-vente sont particulièrement actifs à l’Ouest et dans le Moyen-Ouest, tandis que les communes du Nord se distinguent par l’importance de la défriche (ou mise en valeur de terres incultes), qui concerne près d’un tiers des ménages. L’intensification foncière concerne généralement les petites exploitations et passe par des cultures de contre-saison ainsi que par l’exploitation de terres de second rang (pentes et plateaux). L’intensification semble poussée par la pression foncière pour la subsistance des ménages dans les zones où la terre est rare, mais aussi par les perspectives de commercialisation, à l’instar des communes étudiées de la zone Ouest.
Alors que le pays est réputé bénéficier de grandes ressources foncières disponibles et inutilisées par l’agriculture, dans les zones analysées ici, l’accès la terre est une contrainte importante pour l’agriculture familiale. La grande majorité des exploitations agricoles familiales étudiées (notamment dans les zones agricoles anciennes) ne supporterait pas une division supplémentaire lors de la transmission intergénérationnelle sans accentuer la pauvreté. Dans ce contexte, la promotion de l’accès à la terre devrait cibler la petite agriculture familiale (et non seulement les projets d’installation d’agriculture commerciale ou de firmes).
Aujourd’hui, les perspectives d’accès aux terres reposent sur quelques leviers ténus. Tout d’abord, les mobilités spontanées interrégionales déjà à l’œuvre et l’activité des marchés fonciers permettent l’accès aux terres des migrants (Rakotomalala et al., 2022, pour l’Ouest). Cette stratégie, déjà précaire, pourrait toutefois se voir de plus en plus contrainte par une rareté des terres désormais observable dans les zones agricoles de l’Ouest et du Moyen-Ouest. Ensuite, dans les localités soumises à une forte pression foncière, les marchés fonciers peuvent, sous certaines conditions (Di Roberto et Bouquet, 2018, pour les Hautes Terres), réduire les inégalités intra-zone en offrant des opportunités d’accès à la terre aux ménages les moins bien dotés. Enfin, l’intensification foncière apparaît aussi comme un levier important pour générer des revenus. Cependant, migration, intensification et leviers fonciers sont très dépendants des dynamiques des territoires. Le désenclavement des espaces ruraux (infrastructures routières, aménagements agricoles) pourrait permettre de mieux valoriser certains territoires pour soulager la pression foncière dans les anciennes zones de peuplement. Pourtant, les espaces agricoles dits « disponibles » ne sont pas exempts de droits fonciers, et les nouvelles installations sont largement dissuadées par l’absence d’infrastructures économiques et sociales (routes, aménagements agricoles, électricité, santé, éducation), par des circuits de commercialisation inexistants et par des problèmes majeurs d’insécurité, liés notamment au vol de bétail.
Références
- Andrianantoandro VT, Bélières JF. 2015. L’agriculture familiale malgache entre survie et développement : organisation des activités, diversification et différenciation des ménages agricoles de la région des Hautes Terres. Revue Tiers Monde 221(1): 69–88. https://doi.org/10.3917/rtm.221.0069. [Google Scholar]
- Andrianirina N. 2013. L’Agriculture pour le développement : pertinence et limites à l’échelle des ménages ruraux. Une approche dynamique comparative pour trois régions de Madagascar. Thèse de doctorat. Montpellier (France): Montpellier SupAgro, 170 p. [Google Scholar]
- Andrianirina N, Benoit-Cattin M, David-Benz H. 2011. Trappes de pauvreté et trajectoires de livelihood des ménages ruraux à Madagascar. Paris (France): International conference on new evidence on poverty traps, 6-7 Octobre 2011. https://agritrop.cirad.fr/562133/1/document_562133.pdf. [Google Scholar]
- Banque mondiale. 2014. Visages de la pauvreté à Madagascar. Évaluation de la pauvreté, du genre et de l’inégalité (no 78131-MG). Banque mondiale. https://documents1.worldbank.org/curated/en/349101468053944572/pdf/781310PRIORITY0erty00French0May0210.pdf. [Google Scholar]
- Bélières JF, Burnod P, Rasolofo P, Sourisseau JM. 2016. The illusion of abundance: Agricultural land issues in the Vakinankaratra region in Madagascar. In: Pesche D, Losch B, Imbernon J, eds. A new emerging rural world − an overview of rural change in Africa. Cirad, Nepad, pp. 56–57. https://www.nepad.org/publication/new-emerging-rural-world-overview-of-rural-change-africa. [Google Scholar]
- Bélières JF, Rasolofo P, Rivolala B, Ratovoarinory R, Ratsaramiarina O, Rabevohitra BN, et al. 2017. Typologies d’exploitations agricoles à Madagascar et contributions méthodologiques : synthèse finale pour le programme WAW. Antananarivo (Madagascar): CIRAD-FAO, 19 p. https://agritrop.cirad.fr/586887/. [Google Scholar]
- Benoit-Cattin M, Dorin B. 2012. Disponible alimentaire et productivité agricole en Afrique subsaharienne une approche dynamique comparative (1961-2003). Cahiers Agricultures 21(5): 337. https://doi.org/10.1684/agr.2012.0589. [CrossRef] [Google Scholar]
- Bosc PM, Sourisseau JM, Bonnal P, Gasselin P (eds). 2015. Diversité des agricultures familiales de par le monde : exister, se transformer, devenir. Versailles (France): Quae, 383 p. http://agritrop.cirad.fr/575193/1/document_575193.pdf. [Google Scholar]
- Boserup E. 1965. The conditions of agricultural growth: The economics of agrarian change under population pressure. London (UK): Allen & Unwin, 124 p. [Google Scholar]
- Boué C. 2013. Changement institutionnel et pratiques de sécurisation des droits fonciers : le cas d’une commune rurale des Hautes Terres malgaches (Faratsiho). Thèse de doctorat. Montpellier (France): Montpellier SupAgro, 304 p. http://www.theses.fr/2013NSAM0025. [Google Scholar]
- Burnod P, Andrianirina R, Boue C, Guibert F, Andrianirina N. 2014. La certification foncière au niveau des ménages ruraux à Madagascar. Perception et effets. Situation en 2011. Antananarivo (Madagascar): Observatoire du Foncier, 137 p. https://agritrop.cirad.fr/574106/. [Google Scholar]
- Burnod P, Rakotomalala H, Andriamanalina BS, Di Roberto H. 2016. Composer entre la famille et le marché à Madagascar. Afrique contemporaine 259(3): 23–39. https://doi.org/10.3917/afco.259.0023. [Google Scholar]
- Burnod P, Rakotomalala H, Bélières JF. 2017. Madagascar: Land and jobs as main drivers of rural migration. Rome (Italy): FAO, 2 p. http://agritrop.cirad.fr/586979/7/ID586979.pdf. [Google Scholar]
- Dabat MH, Gastineau B, Jenn-Treyer O, Rolland JP, Martignac C, Pierre-Bernard A. 2008. L’agriculture malgache peut-elle sortir de l’impasse démo-économique ? Autrepart 46: 189–202. https://doi.org/10.3917/autr.046.0189. [CrossRef] [Google Scholar]
- Di Roberto H. 2019. Stratégies d’autonomisation des jeunes et accès au foncier. Entre migration et attachement à la terre, quel rôle pour la famille ? Structure agraire et accès des jeunes à la terre. Regards sur le Foncier 7: 38–52. [Google Scholar]
- Di Roberto H. 2020. Le marché foncier, une affaire de famille ? Une analyse institutionnelle des transactions de terres agricoles dans les Hautes Terres à Madagascar, Thèse de doctorat. France: Université de Montpellier, 423 p. https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-03031144. [Google Scholar]
- Di Roberto H, Bouquet E. 2018. Le rôle de la famille dans la régulation des marchés fonciers à Madagascar. Économie rurale 366(4): 81–96. https://doi.org/10.3917/ecru.366.0081. [CrossRef] [Google Scholar]
- Droy I, Bidou JE, Randriamiandrisoa J, Thomas AC. 2013. Une pauvreté rurale étendue et multiforme. In: Gastineau B, Gubert F, Robilliard AS, Roubaud F, eds. Madagascar face au défi des Objectifs du millénaire pour le développement. Marseille (France): IRD Éditions, pp. 53–85. https://doi.org/10.3917/ecru.366.0081. [Google Scholar]
- Droy I, Bidou JE, Rasolofo P. 2010. Pauvreté et sécurisation foncière : les atouts et incertitudes d’une gestion décentralisée à Madagascar. Taloha 19(19). http://www.taloha.info/document.php?id=867. [Google Scholar]
- Droy I, Ratovoarinory R, Roubaud F. 2000. Les observatoires ruraux à Madagascar : une méthodologie originale pour le suivi des campagnes. Statéco (95-97): 123–139. [Google Scholar]
- Gaitán-Cremaschi D, Klerkx L, Aguilar-Gallegos N, Duncan J, Pizzolón A, Dogliotti S, et al. 2022. Public food procurement from family farming: A food system and social network perspective. Food Policy 111: 102325. https://doi.org/10.1016/j.foodpol.2022.102325. [Google Scholar]
- Gondard-Delcroix C. 2009. Risque, Pluriactivité Rurale et Dynamiques de Pauvreté en Milieu Rural Malgache. Journal of Human Development and Capabilities 10(1): 77–101. https://doi.org/10.1080/14649880802675275. [Google Scholar]
- Guirkinger C, Platteau JP. 2015. Transformation of the family farm under rising land pressure: A theoretical essay. Journal of Comparative Economics 43(1): 112–137. https://doi.org/10.1016/j.jce.2014.06.002. [Google Scholar]
- Guirkinger C, Platteau JP. 2019. The Dynamics of Family Systems: Lessons from Past and Present Times ([CEPR Discussion Paper] no DP13570). Social Science Research Network. https://papers.ssrn.com/abstract=3350347. [Google Scholar]
- Haggblade S, Hazell P, Reardon T. 2010. The Rural Non-farm Economy: Prospects for Growth and Poverty Reduction. World Development 38(10): 1429–1441. https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2009.06.008. [Google Scholar]
- Havard M, Fall A, Njoya A. 2004. La traction animale au coeur des stratégies des exploitations agricoles familiales en Afrique subsaharienne. Revue d’élevage et de médecine vétérinaire des pays tropicaux 57(3-4): 183–190. https://doi.org/10.19182/remvt.9889. [Google Scholar]
- Headey D, Dereje M, Taffesse AS. 2014. Land constraints and agricultural intensification in Ethiopia: A village-level analysis of high-potential areas. Food Policy 48: 129–141. https://doi.org/10.1016/j.foodpol.2014.01.008. [Google Scholar]
- HLPE. 2013. Investing in smallholder agriculture for food security. Rome (Italy): the High Level Panel of Experts on Food Security and Nutrition of the Committee on World Food Security, 112 p. https://www.fao.org/3/i2953e/i2953e.pdf. [Google Scholar]
- INSTAT. 2020. Troisième recensement général de la population et de l’habitation de Madagascar (RGPH-3). Résultats globaux. Tome 1. Madagascar: Institut National de la Satistique (INSTAT). https://www.instat.mg/wp-content/uploads/Resultat-globaux-RGPH3-Tome-01.pdf. [Google Scholar]
- INSTAT. 2022. Mesure et cartographie de la pauvreté non monétaire des ménages et de la population à Madagascar. RGPH 3. Antananarivo (Madagascar): INSTAT, 149 p. https://www.instat.mg/documents/upload/main/INSTAT-RGPH3_MesureCartoPauvreteNonMonetaireMenages.pdf. [Google Scholar]
- Jayne TS, Chamberlin J, Headey DD. 2014. Land pressures, the evolution of farming systems, and development strategies in Africa: A synthesis. Food Policy 48: 1–17. https://doi.org/10.1016/j.foodpol.2014.05.014. [Google Scholar]
- Losch B. 2016. Appuyer les dynamiques territoriales pour répondre au défi de l’emploi des jeunes ruraux. Afrique contemporaine (259): 118–121. https://doi.org/10.3917/afco.259.0118. [Google Scholar]
- Losch B, Fréguin-Gresh S, White ET, Giordano T, Bélières JF. 2010. Structural dimensions of liberalization on agriculture and rural development. A cross-regional analysis on rural change: Synthesis report of the Ruralstruc program, 222 p. https://agritrop.cirad.fr/562894/. [Google Scholar]
- Malthus TR. 1798. An Essay on the Principle of Population, as it affects the future Improvement of Society. London (UK): J. Johnson, 1st edition, 397 p. https://oll.libertyfund.org/titles/malthus-an-essay-on-the-principle-of-population-1798-1st-ed. [Google Scholar]
- Mercandalli S, Losch B, Belebema MN, Bélières JF, Bourgeois R, Dinbaho MF, et al. 2019. Rural migration in sub-Sahara Africa: Patterns, drivers and relation to structural transformation. Rome (Italy): FAO and CIRAD, 100 p. https://doi.org/10.4060/ca7404en. [Google Scholar]
- Ministère de l’Agriculture, de l’elevage et de la pèche. 2009. Deuxième rapport national sur l’état des ressources phytogenetiques pour l’alimentation et l’agriculture. Madagascar: MAEP, 91 p. https://www.fao.org/4/i1500e/Madagascar.pdf. [Google Scholar]
- Minten B, Randrianarisoa JC, Randrianarison L, Food C. 2003. Agriculture, pauvreté rurale et politiques économiques à Madagascar. Cornell Food and Nutrition Policy Program. http://www.hayzara.org/index.php/eng/content/download/496/4084/version/2/file/2003+-+Agriculture+pauvret%C3%A9+rurale+et+Politiques+Economiques+a+Madagascar.pdf. [Google Scholar]
- Rakotomalala H, Bouquet E, Burnod P. 2022. Marchés fonciers et accès à la terre des migrants dans l’Ouest de Madagascar : opportunités et contraintes. Économie rurale (381): 79–93. https://doi.org/10.4000/economierurale.10375. [CrossRef] [Google Scholar]
- Randrianarison L, Andrianirina N, Ramboarison R. 2009. Changements structurels des économies rurales dans la mondialisation Programme RuralStruc − Phase II. Antananarivo: RuralStruc Madagascar. http://siteresources.worldbank.org/AFRICAEXT/Resources/RURALSTRUC-MADAGASCAR_Phase2.pdf. [Google Scholar]
- Razafindrakoto M, Roubaud F, Wachsberger JM. 2018. L’énigme et le paradoxe : économie politique de Madagascar. Montpellier (France): IRD Editions. [Google Scholar]
- RGPH. 2018. Résultats globaux du troisième recensement général de la population et de l’habitation. Antananarivo (Madagascar). https://www.instat.mg/p/resultats-definitifs-du-rgph-3-2018-troisieme-recensement-general-de-la-population-et-de-lhabitation. [Google Scholar]
- Sourisseau JM (ed). 2015. Family Farming and the Worlds to Come, 1st ed. Dordrecht (The Netherlands): Springer, 361 p. https://doi.org/10.1007/978-94-017-9358-2. [Google Scholar]
- Sourisseau JM, Rasolofo P, Belières JF, Guengant HKR, Bourgeois R, Théodore T, et al. 2016. Diagnostic Territorial de la Région du Vakinankaratra à Madagascar. Paris (France): AFD, 157 p. http://agritrop.cirad.fr/580518/1/Rapport%20diagnostic%20prospective%20Vakinankaratra_VFevrier2016.pdf. [Google Scholar]
- World Bank. 2017. Agriculture et developpement rural a Madagascar: Background papers (no 113954). World Bank. https://documents1.worldbank.org/curated/ru/711841491218973857/pdf/113954-WP-FRENCH-PUBLIC-Abstract-sent.pdf. [Google Scholar]
Citation de l’article : Di Roberto H, Belieres J-F, Burnod P, Rakotomalala H, Bouquet E, Raharimalala S, Raharison T, Randriamihary SF, Razafimahatratra HM, Raveloson K. 2025. Rareté foncière, inégalités et intensification à Madagascar : une analyse comparée à l’échelle des ménages dans cinq zones contrastées. Cah. Agric. 34: 23. https://doi.org/10.1051/cagri/2025024
Liste des tableaux
Localisation, année et nombre d’exploitations agricoles (EA) de l’échantillon.
Location, year and number of farms in the sample.
Caractéristiques des exploitations selon les communes, regroupées par zone agroécologique.
Farm characteristics by commune, grouped by agro-ecological zone.
Contributions relatives des différents modes d’accès à la terre.
Relative contribution of different modes of access to land.
Liste des figures
 |
Fig. 1 Cadre d’analyse : déterminants et effets de la rareté foncière ; en grisé, les aspects traités dans cet article. Analysis framework: determinants and effects of land scarcity; in grey, the aspects dealt with in this article. |
| Dans le texte | |
 |
Fig. 2 Carte des zones agroécologiques (à gauche) et des communes étudiées (à droite). Map of agro-ecological zones (left) and surveyed municipalities (right). |
| Dans le texte | |
 |
Fig. 3 Types de parcelles : illustration avec un paysage des Hautes Terres. Plot types: illustration with a Hautes Terres landscape. |
| Dans le texte | |
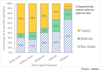 |
Fig. 4 Composition des terroirs appropriés dans les zones agroécologiques. Composition of land used in agro-ecological zones. |
| Dans le texte | |
 |
Fig. 5 Répartition des exploitations agricoles et des superficies possédées selon les classes de superficie par exploitation et par zone. Distribution of farms and acreage owned according to acreage classes per farm and zone. |
| Dans le texte | |
 |
Fig. 6 Évolution du taux de mise en valeur selon la superficie agricole utile de l’exploitation. Evolution of the development rate according to the usable farm area. |
| Dans le texte | |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.




